Le festival Hypermondes s’est tenu à Merignac les 20 et 21 septembre 2025, sur le thème des Voyages. Nous y étions pour la première fois l’année dernière, et nous avons naturellement décidé d’y retourner cette année. Comme le veut la tradition, nous partageons ici notre expérience, en commençant par les conférences et tables rondes auxquelles nous avons assisté. En réalité, le festival off avait commencé la veille… au restaurant, mais chut.
Cette année, j’ai pris des notes — sur un carnet acheté au tabac-presse, car j’avais oublié mon petit carnet des Imaginales, snif et en utilisant une application d’enregistrement sur mon smartphone. Ce billet promet d’être long, parce que ces tables rondes étaient diablement intéressantes…
À 11h10 le samedi, nous assistons à notre première table ronde de la journée. Intitulée Comment publier des nouvelles ? elle réunissait Jérôme Vincent, Oliver Girard et Silène Edgar. Installés dans un bar à vins, à l’heure de l’apéro, nous avons opté pour une eau pétillante (il fallait rester sérieux, tout de même, surtout quand on veut prendre des notes). Toutes les photos de M. Lhisbei sont visibles ici.

Olivier Girard a rappelé l’importance du format court dans l’histoire et l’identité de la science-fiction. Le genre est né à travers les nouvelles, qu’il s’agisse de Lovecraft, Edgar Allan Poe ou Robert E. Howard, qui ont davantage écrit de nouvelles que de romans — parfois même des fix-up, ces ensembles de textes courts reliés entre eux. Aux États-Unis, le développement de la science-fiction moderne est étroitement lié à la typologie éditoriale des pulps et des magazines, qui ont permis à de nombreux auteurs d’émerger.
« Le format court est le cœur battant de la SF », souligne Olivier Girard.
C’est dans cet esprit que Le Bélial’ consacre une collection entière aux recueils de nouvelles, la collection 42. Olivier Girard insiste : être éditeur, c’est d’abord être lecteur, et la nouvelle reste un terrain d’expérimentation et de curiosité. Il rappelle également que le format court se décline en plusieurs formes, notamment la novella, format plus long que la nouvelle, représentée au Bélial’ par la collection Une Heure-Lumière. Si l’on répète souvent que les nouvelles se vendent mal, Girard les compare à un bouquet de fleurs, « avec des parfums différents », qui offrent une diversité et une richesse uniques. L’arrivée de plusieurs collections consacrées aux novellas montre qu’il y a de la place sur le marché français pour ce format.
Pour Jérôme Vincent, éditeur chez ActuSF, « faire court, c’est difficile ».
Le format impose une rigueur d’écriture et constitue une excellente école pour les auteurs. Cependant, éditer, publier et vendre un recueil de nouvelles reste un exercice complexe dans un pays où domine la culture du roman.
Chez ActuSF, un des formats qui fonctionne bien consiste à associer auteurs et un scientifiques autour d’un thème commun — comme dans les recueils Nos futurs ou Nos futurs solidaires. La nouvelle devient alors un vecteur d’exploration thématique, permettant d’aborder des sujets de société ou des réflexions prospectives sous un angle original. Les anthologies annuelles liées aux Utopiales fonctionnent aussi très bien. Les anthologies occupent une place particulière dans le paysage de la science-fiction. Certaines se présentent comme de véritables manifestes, soit en abordant une thématique forte, soit en proposant un état des lieux du genre à un moment donné. Elles ont souvent pour vocation de croiser des auteurs confirmés et de nouvelles plumes, à l’image d’Escales sur l’horizon. D’autres anthologies, plus expérimentales, servent de laboratoires narratifs : elles testent de nouvelles approches, de nouveaux formats ou registres, et deviennent parfois les marqueurs d’une génération ou d’une époque.
Silène Edgar évoque l’anthologie Amazonies spatiales et souligne que la nouvelle est aussi un lieu d’apprentissage pour les auteurs.
Elle repose sur une série de contraintes formatrices — contraintes de taille, de narration et de thématique — qui obligent à aller à l’essentiel, à trouver la justesse du ton et la précision du propos. Pour elle, le format court constitue ainsi un exercice d’écriture exigeant.
Les intervenants ont aussi abordé la question des prix littéraires.
Pour Olivier Girard, « un prix, c’est une carte à jouer : tout dépend de ce qu’on en fait ».
Jérôme Vincent ajoute que c’est aussi une reconnaissance, un argument de vente pour les commerciaux et une réassurance pour les éditeurs.
Après la pause déjeuner (un effiloché de bœuf – 10h de cuisson accompagné d’un verre de vin, tout vient à point à qui sait attendre), direction la table ronde Retour vers le passé avec Antoine Bauza, Bryan Talbot, Robert Vergnieux et Jean-Luc Rivera en modérateur. Toutes les photos de M. Lhisbei sont visibles ici.

Jean-Luc Rivera introduit le concept d’uchronie inversée : au lieu de modifier le futur à partir d’un passé divergent, on modifie le passé depuis le présent grâce à de nouvelles découvertes ou relectures. Il invite Robert Vergnieux, égyptologue, à ouvrir la discussion à partir de son expérience de chercheur. Celui-ci décrit son travail comme un “retour permanent vers le passé”. En étudiant la ville d’Amarna (capitale du culte d’Aton sous Akhenaton), il met en lumière un processus proche de la création uchronique : les nouvelles découvertes réécrivent sans cesse l’histoire officielle et la version précédente devient une “uchronie dépassée”. Grâce à la reconstitution 3D, il “circule” virtuellement dans Amarna : rues, pistes de chars, tombes, maisons. Ce travail confronte les données matérielles et les récits historiques pour construire plusieurs narrations possibles du passé, comme autant de versions parallèles d’une même histoire.
Antoine Bauza explique que le jeu de société est un médium naturellement uchronique : les wargames et jeux de civilisation utilisent des cadres historiques mais chaque partie produit un résultat alternatif, une divergence par rapport à l’histoire réelle. Ainsi, le jeu devient une expérience de narration collective où “on écrit soi-même son petit bout d’histoire”. Dans Seven Wonders, chaque joueur développe une cité antique qui peut dominer le monde d’une manière jamais advenue. Et avec Victorian Masterminds, il s’approprie l’esthétique steampunk pour faire s’affronter des “génies du crime” dans une Europe victorienne alternative.
Bryan Talbot raconte qu’il a été l’un des pionniers du steampunk en BD avec The Adventures of Luther Arkwright dans les années 1970 et qu’il a été influencé par Michael Moorcock et la mode victorienne des années 1960. Dans Grandville, Napoléon a gagné à Waterloo. Deux siècles plus tard, le monde est dominé par un empire français steampunk, peuplé d’animaux anthropomorphes. Le titre vient du caricaturiste français J.J. Grandville, dont les animaux humanisés ont inspiré John Tenniel pour Alice au pays des merveilles.
Jean-Luc Rivera évoque les théories pseudo-scientifiques affirmant que les Égyptiens possédaient des technologies avancées aujourd’hui perdues (machines, hélicoptères, électricité … Robert Vergnieux dénonce ces dérives et insiste sur le fait que l’égyptologie est une science avec une expertise qui nécessite des années de travail. L’égyptologie attire un grand nombre de théories alternatives qui circulent dans les médias et sur Internet et sont souvent présentées comme des “révélations” alors qu’elles reposent sur des erreurs de lecture ou des interprétations fantaisistes. Cela brouille le message scientifique et donne au public une vision déformée du passé. Les outils numériques (modélisation, réalité virtuelle) sont souvent utilisés comme arguments “d’autorité”. Or, la 3D n’est pas une preuve, seulement une visualisation. Les chercheurs s’en servent pour comprendre, pas pour démontrer des hypothèses fantaisistes. Il prend l’exemple du prétendu hélicoptère visible sur une frise du temple d’Abydos. C’est une illusion d’optique historique. À l’origine, une inscription hiéroglyphique avait été gravée sur une cartouche. Elle a été recouverte de plâtre, puis regravée sous le règne d’un autre pharaon. Avec le temps, le plâtre s’est détérioré, révélant deux textes superposés dont les signes, combinés, évoquent vaguement la forme d’un hélicoptère. En réalité, il s’agit simplement de la superposition d’une corbeille et d’un pain. Robert Vergnieux souligne que ces mythes détournent l’attention de la véritable grandeur de l’Égypte ancienne — celle de l’ingéniosité humaine. Il explique que l’Égypte est la seule civilisation à relier sans rupture préhistoire, protohistoire et histoire, ce qui en fait un terrain privilégié pour réfléchir à l’émergence du savoir et de la culture humaine. Antoine Bauza mentionne son jeu Arkeis, une uchronie égypto-steam où les Égyptiens disposent de la vapeur et de l’électricité pour construire les pyramides.
Robert Vergnieux évoque le pharaon Aton et se lance dans un petit exercice d’uchronie : s’il avait su organiser sa succession, la religion et la conception de l’homme auraient pu évoluer autrement, modifiant peut-être le destin spirituel de l’humanité.
M. Lhisbei a assisté à une partie de la Rencontre avec François Schuiten et Benoît Peeters modérée par Lloyd Chéry, pendant que j’étais je ne sais où, probablement en train de discuter avec quelqu’un quelque part. Pas de notes mais voici les photos ici.

Le dimanche, beaucoup de papotages et une longue pause au resto le midi (un service défaillant mais nous étions en excellente compagnie) ont eu raison de notre motivation pour assister aux conférences de l’après-midi. Reste la très bonne table ronde du matin Vers l’espace et au-delà ! avec Floriane Soulas, Laurent Genefort, Roland Lehoucq et Jean-Claude Dunyach à la modération. Les photos de M. Lhisbei sont ici.


Jean-Claude Dunyach ouvre la table ronde en présentant les intervenants, tous titulaires de doctorats. Floriane Soulas a un doctorat en génie mécanique, est ingénieure et autrice de science-fiction (steampunk, cyberpunk, space opera). Roland Lehoucq, doctorat en astrophysique est astrophysicien, vulgarisateur scientifique. Il écrit des livres et des articles de vulgarisation scientifique qui mélangent science et science-fiction. Laurent Genefort est docteur en littérature avec une thèse sur les livres univers de la science-fiction. Il est l’auteur d’une cinquantaine de romans de science-fiction. Il pose ensuite le thème de la table ronde : le voyage spatial comme métaphore et comme moteur de la science-fiction.
Le voyage vers l’espace est un thème classique de la science-fiction, l’hêtre humain est souvent fasciné par l’espace : lever les yeux et se demander « pourquoi ne pas aller là-bas ? ». La science et la politique se sont emparées du sujet du voyage spatial : exploration spatiale, conquête de nouvelles frontières, et implication récentes de riches entrepreneurs qui rêvent de coloniser Mars par exemple.
Roland Lehoucq a découvert Saturne dans une lunette quand il était petit et rêve de pouvoir être en orbite autour de Saturne pour l’observer de près. Il critique avec humour Interstellar, film dans lequel les astronautes jouent au baseball au lieu de contempler la planète.
Laurent Genefort pense que l’espace est vide et hostile. L’intérêt des voyages spatiaux réside dans l’adaptation nécessaire de l’humain à cet environnement extrême. Les vaisseaux générationnels deviennent des micro-civilisations isolées, traités comme des mondes à part entière. Et dans Spire, il explore comment faire civilisation dans l’espace. Le vide spatial, par sa dangerosité, pousse à la mutation, à la redéfinition du corps et de la société.
Floriane Soulas a imaginé une population marginalisée vivant en orbite autour de Jupiter. Jupiter, planète inaccessible, est devenu devient une décharge de l’humanité et les exclus, criminels ou marginaux, y créent une civilisation du rebut. Elle invente une société régie par le cycle de dépressurisation de l’air (tous les trois jours), qui sert de repère temporel. Floriane Soulas explique que son objectif était de réfléchir à la survie collective dans un milieu extrême : comment maintenir un groupe quand tout pousse à l’individualisme ? Les habitants de Jupiter oscillent entre solidarité contrainte et loi du plus fort.
Laurent Genefort revient sur ses romans récents (Les Temps ultramodernes et La Croisière bleue) , qui revisitent la planète Mars des imaginaires anciens. Il évoque les idées de l’époque : atmosphère martienne, faune, flore, civilisations martiennes et s »inscrit dans un rétro-futurisme scientifique, combinant les connaissances d’alors et nos questionnements actuels (colonialisme, écologie). Pour lui revisiter les mythes de la SF ancienne permet de réfléchir à notre rapport actuel à la science et à la conquête.
Jean Claude Dunyach revient au présent et aborde la question des voyages touristiques spatiaux. Il évoque les projets d’hôtels en orbite terrestre, accessibles à quelques riches. Roland Lehoucq dénonce le coût écologique absolument immense et la futilité de ces voyages (le plaisir de quelques uns au prix du ascrifice de l’environnement de tous). Il ironise sur le « milliardaire transformé par la vision de la Terre » par un hublot alors même que cette épiphanie a émis 30 000 tonnes de CO₂. Floriane Soulas pense que les auteurs de SF, très conscients des enjeux écologiques, refuseraient d’y aller : le prix moral est trop élevé.
Le débat revient sur les vaisseaux générationnels, symboles de la finitude que Jean-Claude Dunyach compare à la Terre : un monde clos, à ressources limitées. Laurent Genefort rappelle qu’ils obligent à penser la gestion collective des ressources et la hiérarchie. Roland Lehoucq cite les romans de Brian Aldiss ou Poul Anderson. Floriane Soulas souligne la difficulté narrative : impossible de raconter mille ans d’évolution, il faut choisir un instant. Créer des civilisations durables dans l’espace exige des tabous, des religions, des mythes intégrés. Dunyach raconte une anecdote vécue : des ingénieurs russes travaillant sur des avions hypersoniques avaient fait appel à des ethnologues pour inventer des mythes religieux expliquant les traînées lumineuses dans le ciel, afin de ne pas effrayer les populations.
Cette « implantation de croyances » illustre comment la fiction peut précéder et orienter la perception du réel.
Jean-Claude Dunyach interroge Floriane Soulas sur les univers numériques et la simulation (Soma son dernier titre relève du cyberpunk). Si l’on peut simuler une vie complète, c’est peut-être que nous vivons déjà dans une simulation.
Photos par C.Schlonsok tous droits réservés à l’auteur
Dans les prochains billets, nous vous parlerons des expositions, des dédicaces et des remises de prix… Restez connectés !

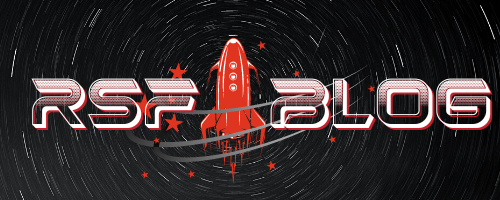


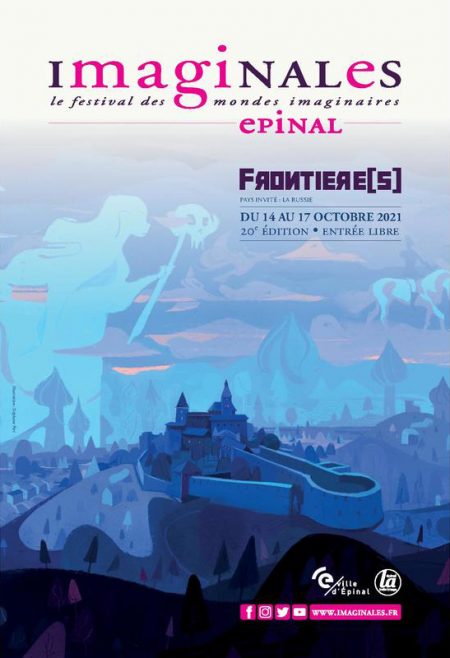
Ce n’est même plus un récap’ là, c’est presque une retranscription complète, impressionnant.
Très malin le concept d’uchronie inversée, j’aime beaucoup !
Nan pas une retranscription complète (c’est beaucoup plus long que ça). Pour les Utos, j’essaierai de faire pareil :p (ou j’attendrai les audios mis en ligne par ActuSF)
Oui, ce concept est une excellente idée. 🙂
Ping : Hypermondes 2025 : expositions et dédicaces - RSF Blog
Ping : Hypermondes 2025 : les remises de prix - RSF Blog