Depuis sa création en 2010, Aux Forges de Vulcain s’est imposée comme l’une des maisons d’édition indépendantes les plus singulières du paysage français. Fondée par David Meulemans, docteur en philosophie et passionné de littératures de l’imaginaire, elle défend des textes exigeants, curieux, souvent inclassables : de la littérature générale nourrie de souffle et de réflexion, à la fantasy et la science-fiction littéraires.
Lors des Utopiales 2025, nous l’avons rencontré pour le RSF Blog et pour lui remettre, avec Gromovar (Quoi de neuf sur ma pile), Cédric Jeanneret (Reflets de mes lectures) et Tigger Lilly (Le dragon galactique), le Prix Planète-SF des blogueurs, attribué cette année à Guillaume Chamanadjian pour Une valse pour les grotesques. Vous trouverez dans ce billet sur le blog du Planète-SF les informations sur la remise de prix. Cette remise s’est accompagnée d’une interview autour du métier d’éditeur et des oeuvres de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier

Photos par C.Schlonsok tous droits réservés à l’auteur
Du philosophe à l’éditeur
Vous aviez un parcours universitaire, en philosophie. Comment êtes-vous arrivé à l’édition ?
Il y a plusieurs éléments.
Enfant puis adolescent, je passais mon temps à dessiner et à lire. À l’école primaire déjà, je fabriquais des petites revues, et j’adorais ce qu’on appelle les “chemins de fer” : organiser, à la main, la disposition de toutes les pages d’un livre ou d’un magazine. Ce n’est pas une passion très répandue, mais pour moi, c’était un plaisir.
Dans ma famille, personne ne travaillait dans ce domaine. Je ne savais même pas qu’il existait des études pour apprendre ces métiers. Alors, par facilité, je me suis dirigé vers ce dans quoi je réussissais le mieux : les dissertations. J’ai donc fait des études de philosophie.
Entre 20 et 30 ans, en tant que jeune enseignant-chercheur, j’ai beaucoup collaboré avec des éditeurs, surtout dans le scolaire et le parascolaire. Comme j’étais philosophe et à l’aise en anglais, je traduisais, rédigeais des préfaces, compilais ou sélectionnais des textes. J’ai également contribué pendant longtemps aux numéros spéciaux de diverses revues. Vous savez, ces numéros sur « art et politique » ou « Dieu existe-t-il ? ».
Cette expérience m’a beaucoup appris sur l’écriture. Et puis, d’une certaine façon, la presse et l’édition sont deux cousines : elles partagent des contraintes, des exigences communes.
L’idée de l’édition a donc commencé à s’imposer. Mais l’élément déclencheur vient du théâtre. De mes 5 à 28 ans, j’ai fait partie de troupes amateures. À 28 ans, marié et père, j’ai compris deux choses : je n’étais pas un très bon comédien et je n’aimais pas les tournées – surtout être loin de ma famille – même si j’adorais la scène. Il me fallait une activité qui canalise cette envie de créer, tout en étant compatible avec une vie de famille. L’édition s’est alors imposée comme une voie naturelle, logique.
Comme j’avais travaillé en indépendant pour des éditeurs, je savais qu’il serait difficile de trouver un poste intéressant en interne. Alors j’ai fait quelque chose d’un peu fou : j’ai créé ma propre maison d’édition. Beaucoup auraient abandonné ou repris des études. Moi, après neuf années d’université, je ne voulais plus retourner sur les bancs de la fac. Alors je me suis lancé.
Le métier d’éditeur et ses surprises
Lorsqu’on devient éditeur, on projette certaines attentes et envies. Dans quelle mesure le métier vous a-t-il surpris ?
La première grande surprise, je ne mesurais pas à quel point l’édition est un commerce. J’étais naïf, mais je pense que c’est parce que j’étais initialement simple lecteur. Et quand on est universitaire en sciences humaines, on est très tourné vers le texte et donc on ne se pose pas toujours de questions de commercialisation. Mes premières missions pour des éditeurs scolaire et le parascolaire n’intégraient pas non plus cette dimension commerciale.
Ce qui est paradoxal, c’est que je viens d’une famille de petits entrepreneurs – un héritage que j’ai longtemps rejeté. Un de mes grands-pères dirigeait une entreprise de rénovation, l’autre une exploitation agricole. J’imaginais passer ma vie dans la fonction publique. Et pourtant, j’ai découvert qu’il y avait dans le commerce quelque chose de ludique, d’exaltant parfois.
Ainsi, ma première surprise a été de découvrir le commerce, et la deuxième, de réaliser que j’aimais ce va-et-vient constant entre le travail du texte et sa rencontre avec le public.
Pour situer un peu le contexte, entre 20 et 30 ans, je rêvais de travailler en politique, mais les postes qui s’offraient à moi étaient liés à des partis dont je ne partageais pas les idées. Je les ai donc tous déclinés. Mais à travers mes lectures et mes échanges avec des gens du milieu politique, je me suis rendu compte que l’édition partage beaucoup de points communs avec la politique.
Il y a toujours deux dimensions : le travail de terrain, qui consiste à rencontrer les gens un par un pour gagner leur voix, et ce que l’on appelle le « tir en cloche » – la communication plus large, destinée à toucher un public que l’on ne rencontre jamais directement.
L’édition fonctionne de la même manière. Il faut à la fois rencontrer un lecteur, partager sa passion pour un livre de façon personnelle, et en même temps formuler un discours capable d’intéresser des inconnus.
La grande différence avec d’autres commerces, c’est qu’ici, il faut rester sincère. On ne peut pas se contenter de vendre à tout prix ; si l’on trompe le lecteur, le livre sera lu… et rejeté, ce qui est parfois pire que de ne pas vendre.
Voilà, ce sont les aspects qui m’ont le plus surpris dans ma découverte du métier, entre 30 et 35 ans.
Et parmi tous les livres que vous avez publiés, y en a-t-il un qui vous a donné des sueurs froides ? Un projet compliqué, ardu à travailler ou ardu à proposer au public ?
En fait, il y a deux aspects.
Le premier concerne les traductions. Elles peuvent être délicates, surtout lorsque l’on maîtrise la langue originale. Dans ce cas, on a parfois envie d’intervenir dans la traduction, mais il faut respecter le travail du traducteur. Et lorsque l’on ne connaît pas la langue, il y a cette inquiétude persistante : « Est-ce que le traducteur a bien saisi le texte original ? » Cela oblige à travailler un peu à l’aveugle.
Le second aspect, ce sont certains textes dont je suis extrêmement fier mais qui n’ont pas totalement trouvé leur public. Par exemple, Souviens-toi des monstres de Jean-Luc A. d’Asciano. Pour moi, c’est un roman-somme, très littéraire, riche, dense et long. Ce type de premier roman est toujours difficile à vendre. Il se vend régulièrement, mais ce n’est pas encore un best-seller. Et pourtant, c’est probablement un des livres dont je suis le plus fier, d’autant que le travail éditorial l’a à peine retouché.
Il y a une citation de Christian Bourgois que tous les éditeurs connaissent et qui résume bien cela : « Éditer des livres, c’est faire lire des livres à des gens qui n’ont pas envie de lire ces livres-là. » C’est exactement ce que ce roman représentait.
Pour ce titre la reconnaissance à l’étranger est une grande satisfaction. Une critique dans Le Monde n’a rien changé aux ventes en France, mais a attiré l’attention d’un éditeur chilien. Le roman a été traduit par un romancier reconnu et publié dans de grandes maisons en Amérique latine. Aujourd’hui, c’est une très belle vente dans plusieurs pays. Pour moi, c’était très gratifiant : ce succès à l’étranger a confirmé que mon enthousiasme pour ce texte n’était pas une illusion.
A propos du roman Une valse pour les grotesques (prix Planète-SF des blogueurs 2025)
Je voudrais revenir sur Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, publié en octobre 2024. Comment ce projet est-il arrivé jusqu’à vous ?
C’est assez simple en fait. Dès que je reçois le stock imprimé d’un livre d’un auteur des forges, généralement deux à quatre semaines avant sa mise sur le marché, j’envoie un mail pour lui annoncer que tout est en ordre et lui demander : « Quel est le prochain texte ? » Dans le cas de Guillaume, il avait déjà le texte prêt, je l’ai reçu le lendemain.
Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier sont extrêmement méthodiques et précis. Je n’ai jamais eu de problème du type texte incomplet ou panne d’écriture. Ils sont métronomiques. Leurs méthodes sont très différentes, ce qui est assez cocasse : d’après, ce que j’ai compris, Guillaume travaille de manière très contemplative, réfléchissant longtemps et construisant ses phrases dans sa tête avant de les poser, tandis que Claire se décrit elle-même comme une autrice besogneuse. Elle écrit phrase par phrase sur l’ordinateur, corrige, reprend… Ce contraste les amuse parfois, les énerve aussi, mais le résultat est toujours de grande qualité..
Pour répondre à votre question, le texte de Guillaume était donc déjà terminé. Même quand un projet comme La Tour de garde s’étale sur plusieurs années (5 ans d’écriture), ils avancent toujours sur d’autres textes en parallèle. Par exemple, le premier roman publié de Claire, Un long voyage, n’était pas son premier écrit, c’est le deuxième qu’elle a écrit et elle l’a produit entre deux volumes de sa trilogie coordonnée avec Guillaume.
Le prochain roman de Guillaume paraîtra en mars prochain, et il l’a écrit en moins de trois mois. Il travaille actuellement sur une œuvre de longue haleine, en plusieurs volumes, et il a eu besoin de faire une pause. De là est né ce court roman de science-fiction, écrit presque d’un seul jet. On sent qu’il y a mis une énergie très dense, comme une respiration nécessaire.
Le texte est terminé, on règle encore quelques détails éditoriaux. Il n’a pas encore de titre – on est en pleine discussion.
À propos du lancement de La Tour de garde
Quand Claire Duvivier m’a annoncé qu’elle avait un projet écrit à quatre mains avec son compagnon, j’ai eu un moment d’inquiétude. L’histoire de l’édition est remplie de projets de couples où l’un des deux n’a pas forcément le recul nécessaire sur la qualité du travail de l’autre. Heureusement, le premier texte terminé était celui de Guillaume. Je l’ai lu en premier… et je l’ai adoré.
À ce moment-là, on n’avait aucune stratégie de publication arrêtée. On a envisagé toutes les options :
- un seul volume gigantesque,
- des volumes réunis par deux,
- ou encore des intégrales (comme celles du Nord et du Sud que l’on publie aujourd’hui).
La décision finale est venue d’un principe assez inhabituel : on veille souvent à ce que les autrices ne soient pas reléguées au rôle « d’épouse de ». Là, je ne voulais pas que Guillaume soit perçu comme « le compagnon de Claire ». Si l’on alternait les auteurs, alors il fallait commencer par lui. Qu’il soit un auteur à part entière des Forges.
Guillaume a un sens naturel de l’entertainment. Le Sang de la cité est un grand roman d’aventure, très accessible : c’était une excellente porte d’entrée dans l’univers de La Tour de garde.
C’est pour cela qu’on plaisante souvent en interne : La Tour de garde, c’est censé être la partie « grand public » du catalogue des Forges. Et pourtant, beaucoup de lecteurs ont été déstabilisés par son ambition. L’accueil de La Tour de garde a finalement été très positif : le bouche-à-oreille est venu de lecteurs pas forcément habitués à ce type de narration, mais qui ont été séduits.
Pour Un long voyage, avant sa sortie, nous avons eu quelques recensions en ligne critiques, qui m’ont surpris : on lui reprochait que ce ne soit pas un roman de fantasy « classique » avec magie et récit d’initiation, alors que de nombreux textes de fantasy ne correspondent pas à ce schéma.
Au fond, le rôle de l’éditeur est veiller à ce que les textes rencontrent leur public. Et c’est cela qui nous procure satisfaction : voir nos auteurs trouver leurs lecteurs et lectrices.

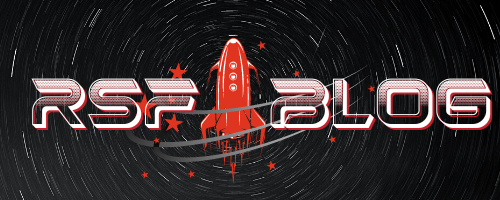

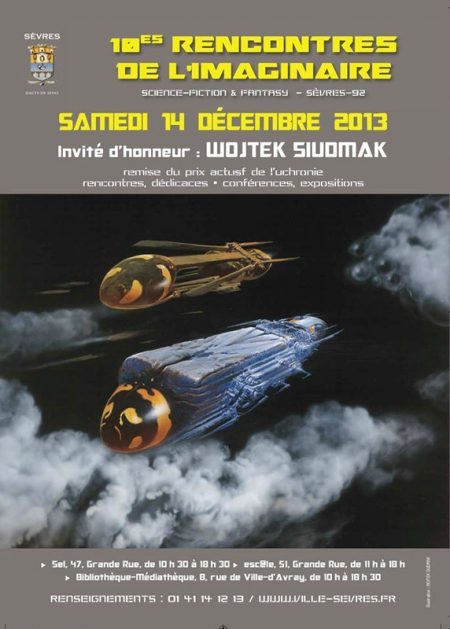
Et leurs couvertures sont toujours magnifiques,en plus des textes.
J’ai du mal à m’en séparer. Merci
Avec plaisir !
Ping : Ils ont rejoint ma PAL (177) - RSF Blog