De Maëlig Duval
Griffe d’encre – 134 pages
Les dieux ont déserté le monde. La vie humaine, dont chaque étape importante était marquée par une rencontre avec un dieu, n’a plus de goût. Perdre les dieux c’est aussi perdre une part de soi. La perte des dieux s’est révélée fatale à tous les plus de 45 ans, tous ou presque puisque les athées qui vivaient sans dieu ont survécu. Les plus plus jeunes ne peuvent plus procréer, la race humaine est devenue stérile. Et lorsque la mort survient, la plume qu’exhalent les défunts, n’est plus récupérée par les dieux. Perspective glaçante pour l’humanité que de perdre l’espoir d’une après-vie.
« Il y avait encore six années de cela, il suffisait de lever les yeux pour voir les dieux émerger des nuages et évoluer, majestueux, blancs diaprés de rose dans le ciel bleu. De loin, ils évoquaient d’immenses raies dont le corps se serait fondu dans les ailes puissantes. Mais c’était quand l’envie de leur raconter le monde devenait forte à faire trembler les lèvres, impérieuse à faire s’emballer le coeur, quand on entrait dans le temple avec la certitude qu’on allait parler à un dieu jusqu’à sentir sa puissance pénétrer les moindres replis de tripes et de chairs, que leur plus grande beauté se révélait. Car le corps entier s’apaisait à leur approche, la peau, les muscles, les poils, le gras, les paupières, les comédons, les ongles, les varices et les muqueuses, enfin tout, le corps entier communiquait quand les lèvres et la langue s’agitaient. L’envergure d’un dieu était telle que, lorsqu’il s’enroulait autour de la statue au pied de laquelle l’attendait, vibrant d’impatience, l’humain venu parler, il la recouvrait souvent deux fois. »
Lorsque les dieux sont partis (et personne ne sait comment ni pourquoi), l’Homme a sombré. Dans la confusion. Dans la douleur. Dans la haine. Jusqu’à la guerre. A présent, l’heure de la reconstruction a sonné et Albert, fonctionnaire zélé du bureau de la Reconstruction, oeuvre à ce renouveau. Sur le terrain, il est chargé de parcourir les zones à rebâtir, de déterminer le meilleur moyen de mener à bien les chantiers. il est aussi chargé de surveiller les groupuscules politiques révolutionnaires ou religieux – évoquer les dieux reste tabou – et de les classer selon leur dangerosité pour le gouvernement en place. Pointilleux à l’extrème, il coche minutieusement les cases de ses formulaires. Ses évaluations se révèlent précises mais dénuées d’humanité. Une humanité qui se rappelle à lui sous la forme d’Eva, survivante d’un petit village désolé qu’il faut raser pour y implanter un centre de maternage, et de son fils atypique, George. George n’est pas un garçon comme les autres, il peut peut-être sauver les dieux.
D’emblée Albert, caricature du bureaucrate tatillon, n’est guère sympathique. Au contact d’Eva et de George, sa carapace va se fendre jusqu’à voler en éclat, rendant l’évolution du personnage intéressante. Jusqu’à la fin, la nature des dieux – et leurs interactions bio-chimiques avec les hommes – restera mystérieuse. Le lecteur pourra choisir l’explication qui correspond le mieux à ses propres croyances. L’écriture de Maëlig Duval, empreinte d’humanité, de poésie, touche une corde sensible chez le lecteur et le prend au piège du récit même pour les quelques passages aux ficelles un peu épaisses ou rocambolesques. L’alternance des points de vue narratifs – le récit centré sur Albert est mis en parallèle avec le journal intime d’Irène, sa maîtresse (oui, Albert est bien moins caricatural qu’il n’en a l’air) – permet de développer la psychologie des personnages, du choc traumatique à la reconstruction en passant par le deuil, de leur donner de la chair, de la consistance et une âme. Sur un récit court, 134 pages, l’auteur réussi à poser un monde dévasté, nostalgique sans se l’avouer d’une époque à jamais révolue, un monde amputé pour lequel le souvenir des dieux attise la douleur. Un monde sans espoir, doublé d’une société dystopique assez solide pour que le lecteur s’y sente mal-à-l’aise et sous tension. un monde que George, un adolescent différent, lumineux va contribuer à changer.
J’ai repéré une belle faute de français sur une phrase qui peut porter à contresens (enfin si j’ai compris et interprété de travers cette phrase, c’est plutôt moi qui aurait l’air d’une belle cruche). Page 40, l’auteure explique que le village appartient à un industriel et note : «Tout le village appartenait à un certain monsieur Truchot, poursuivit-il d’une voix procédurière. Les habitants travaillaient pour lui à la fabrique et lui payaient le loyer des maisons. Ce monsieur Truchot est décédé sans héritier connu. Le village est devenu propriété d’Etat. » Compte tenu du contexte je comprends que Truchot payait les loyers pour les salariés de sa fabrique (modèle paternaliste, identique à ce qu’on peut connaître dans les régions minières ou à feu la cristallerie d’Arques par exemple). La conjugaison du verbe payer est donc erronée dans l’extrait cité. Enfin si je ne comprends pas de travers. Et si je ne comprends pas de travers, cette scorie se révèle étonnante quand on connait le soin que met l’éditeur à choisir et corriger les textes qu’il publie, et quand on connaît le parcours de la novella (passée dans les mains des grenouilles bêta-lectrices de Cocyclics). Si j’ai compris de travers, vous êtes bien entendu (cordialement) invités à me conspuer (cordialement) dans les commentaires.
Mis à part ce petit détail de rien du tout (détail qui m’a tout de même sauté aux yeux sinon je n’en parlerais pas), cette novella reste plus qu’enthousiasmante. J’en recommande chaudement la lecture..
Un extrait gourmand pour terminer :
« La brioche, murmura-t-elle, c’est doux, c’est chaud et ça se mange. Ça fond sous la langue et ça réconforte. L’odeur de la brioche, c’est tout cela avec l’espoir en plus. L’odeur de la brioche, ça te réchauffe le ventre d’avance, ça emplit ton coeur d’amour et ça t’emmitoufle dans un gigantesque coussin moelleux. L’odeur de la brioche, c’est le soleil quand il fait beau, le feu quand il fait froid, la potage quand tu es affamé, mes bras quand tu as peur. Et les petits cristaux de sucre grillés que tu vois sur le dessus, c’est la fraîcheur d’un éclat de rire, l’eau clair qui ruisselle sur ta peau, le criquet qui chante sous le brin d’herbe. Tout cela ensemble, c’est l’odeur de la brioche au sucre, et comme elle sort juste du four,elle enroule autour de toi son fumet généreux et tu as l’impression de me serrer dans tes bras. »
Personnellement, je reprendrais bien une tranche de cette brioche. J’espère donc avoir à nouveau l’occasion de lire un texte de Maëlig Duval.
- Lire un extrait
- Lire les avis de Phénix-web, SFFF 100% VF, Un monde de nouvelles, Callioprofs, Les Lectures de Castel Platypus, Pégase mécanique

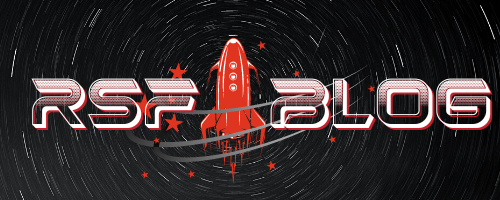


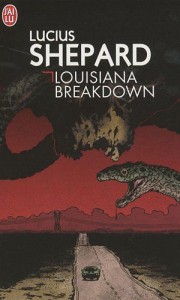

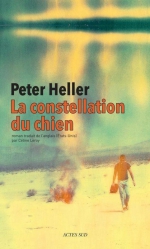
Eh bien, Lhisbei, je te conspue : ils payaient à lui -> ils lui payaient. Donc : “Les habitants travaillaient pour lui à la fabrique et lui payaient le loyer des maisons.” = “Les habitants travaillaient pour lui à la fabrique et [ils] lui payaient le loyer des maisons.”
ah oui. j’ai mal compris le mécanisme des loyers et la propriété des logements. merci. comme quoi on est jamais à l’abri d’une incompréhension…
Il serait peut-être correct de modifier la chronique, afin que des lecteurs qui ne liraient pas les commentaires ne pensent pas que Griffe d’encre a laissé une coquille pareille…
Un très bon souvenir de lecture !
Et je crois que tout le monde est conquis par la brioche au sucre de Maelig Duval
C’est aussi ce qu’elle m’a dit au moment de la dédicace … D’ailleurs je suis passé à la boulangerie juste avant critic et le petit garçon devant moi a pris une brioche au sucre, j’avais un sourire jusqu’au oreille … Et Conor qui m’accompagnait à ramasser une plume par terre.
M’a l’air bien intéressant tout ça, merci !
La phrase est limpide quand on rajoute le sujet implicite du second verbe. Faut arrêter la bière ma petite… :p