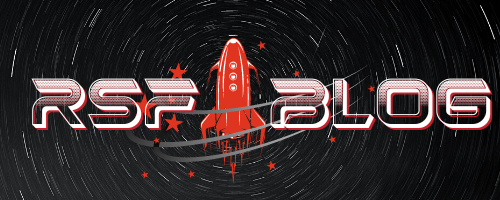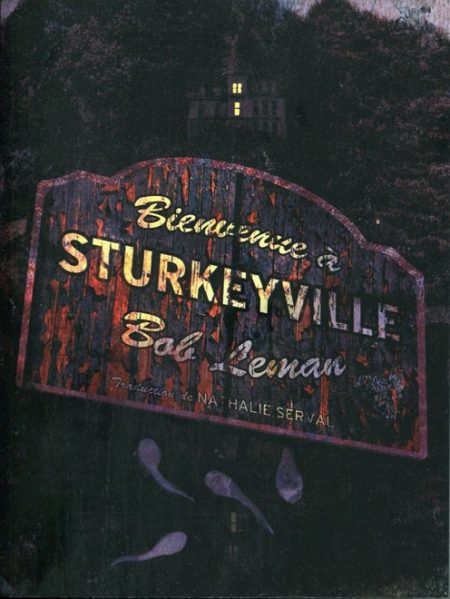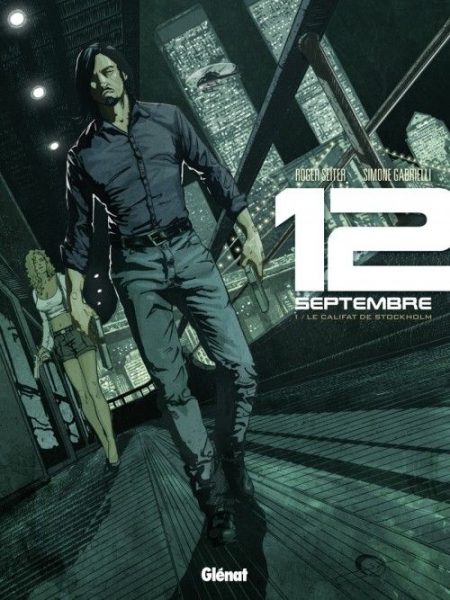De C. J Carey
Éditions du Masque – 392 pages. Traduction de Fabienne Gondrand.
Retour de chronique du Bifrost 108
Lors de la Seconde Guerre mondiale, Churchill a échoué à imposer ses vues à la classe politique anglaise, et l’aristocratie britannique a préféré pactiser avec l’Allemagne pour éviter l’affrontement militaire. Les États-Unis ne sont pas entrés en guerre et le pacte germano-soviétique n’a pas été rompu. Le Reich, après son triomphe, a placé le Royaume-Uni sous protectorat. Le peuple anglais subit la propagande et la privation de libertés avec son flegme emblématique. Le roi George VI, sa famille et nombre de membres de la royauté anglaise ayant trépassé au moment opportun, Édouard VIII et son épouse Wallis ont accédé au trône et, en 1953, les festivités de leur couronnement officiel approchent. Le pouvoir, en réalité, est exercé par le Protecteur Alfred Rosenberg, l’un des plus anciens compagnons de route du Leader, Adolf Hitler.
Rosenberg, bien décidé à faire de l’Angleterre un modèle de société parfaite, impose ses lois drastiques : contrôle total de l’information, absence de contact avec l’extérieur, interdiction de se cultiver ou de penser par soi-même, normes et hiérarchies sociales strictes corrélées à des menaces de déclassement, surveillance et délation des citoyens par les citoyens, police toute puissante chargée de faire respecter l’ordre établi. Et comme le pays compte à présent deux femmes pour chaque homme – la guerre et la résistance à l’Alliance ont décimé les rangs des jeunes hommes –, ces dernières subissent de plein fouet une classification en fonction de leurs caractéristiques génétiques et familiales qui génère des droits plus ou moins nombreux. Certaines catégories se trouvent même affublées d’un surnom inspiré par une femme ayant marqué la vie du Leader. Les femmes de l’élite, destinées à épouser la crème du royaume, sont appelées Geli, hommage à la nièce adorée du Leader (qui, rappelons-le, s’est suicidée pour se libérer de l’emprise de ce dernier). Les Klara (de la mère du Leader) sont les mères de la Patrie, priées de fournir quatre enfants minimum. Les Paula (d’après la sœur de Hitler) sont enseignantes ou infirmières. En descendant l’échelle sociale, on trouve les professions subalternes (Magda), puis le personnel de maison (Gretl), et une infinité d’autres désignation jusqu’au bas de la hiérarchie et ses Frieda (pour Friedhöfefrauen, littéralement « femmes cimetières »). Ces veuves et vieilles filles, sans mari à servir ni enfant à élever, réputées inutiles, survivent dans des quartiers miséreux de banlieue appelés Widowland.
Rose Ransom, une Geli bien intégrée malgré une liaison avec son supérieur, un homme marié, travaille pour le ministère de la Culture, où elle rend les classiques anglais plus conformes aux principes de la société nazie, non sans cacher les effets que cette littérature produit sur elle. Les préparatifs du couronnement et la visite de Hitler, imminente, occupent les esprits. Sur les murs de la ville d’Oxford, lieu de la cérémonie, apparaissent des citations subversives issues d’œuvres censurées. Rose est envoyée enquêter dans le Widowland, puisque la Gestapo peine à y dénicher les séditieuses autrices de ces graffitis. De parcours initiatique dans une dystopie uchronique, le roman bascule dans un thriller non dénué de quelques facilités (comme un interrogatoire bien trop gentillet au regard de l’atmosphère délétère ambiante).
Widowland met en lumière le pouvoir subversif de la littérature, une arme puissante pour lutter contre la tyrannie et l’oppression, en particulier lorsqu’elle est maniée par les plus opprimées. S’il ne révolutionne pas le genre – on pensera, entre autres, à La Servante écarlate ou à Fatherland — il remplit son office et nous rappelle combien les femmes qui lisent sont dangereuses…
Un extrait
Ce matin-là, la visite de Rose à la London Library avait pour prétexte une version corrigée de Jane Eyre qui n’allait pas tarder à être distribuée dans les écoles et les bibliothèques. Le texte était problématique à plus d’un titre. L’histoire d’amour concernait une femme de basse extraction qui s’éprenait d’un homme d’ordre supérieur et désirait l’épouser. Pourtant, quand enfin elle s’attachait son affection, elle le quittait. Le récit était truffé d’affirmations sur l’autosuffisance des femmes. Leur autonomisation, leur indépendance, leur connaissance d’elles-mêmes. Chaque page ou presque exigeait une retouche.
Rose en était arrivée au passage où Jane admoneste Edward Rochester, dont elle pense à tort qu’il va épouser une femme de plus haute caste.Croyez-vous que je sois un automate, une machine privée de sentiments, que je puisse supporter de voir arracher de mes lèvres la bouchée de pain, vider de ma coupe la goutte d’eau vivifiante ? Croyez-vous, parce que je suis pauvre, humble, sans agréments, petite, que je sois sans âme et sans cœur ? Vous vous trompez ! J’ai une âme comme vous, et autant de cœur !
Il n’y avait pas grand-chose à faire de ce ramassis de subversion, si ce n’était le biffer.
Mais Rose était bien obligée de reconnaître que plus le temps avançait, plus elle avait du mal à s’acquitter de son travail de correction. Plus elle lisait, plus elle aimait à se penser comme une collaboratrice plutôt que comme une correctrice. Elle se sentait de plus en plus proche de l’autrice, avec qui elle se sentait respirer à l’unisson, main dans la main, comme si c’était elle qui lui avait confié cette immense tâche. Cette proximité rendait impossible toute tentative de censure expéditive. Dans son travail de correction, Rose faisait de son mieux pour ne rien perdre de la tension et de la clarté de l’intrigue : elle préservait le flux du récit, remodelait les paragraphes, imitait le style, conservait son rythme et sa fluidité. Elle était rompue à la pulsation des syllabes et à la petite musique des phrases. Peut-être cette rencontre entre les esprits était-elle l’essence même du travail de révision.
Quand tout se passait bien, Rose s’infiltrait dans les lignes du roman comme une espionne. Une agente qui opérait de l’intérieur.