De Ted Chiang
Denoël Lunes d’encre – 352 pages
Bon, bon, bon. Par où commencer ? Par une affirmation ? Comme celle-ci : “les textes de Ted Chiang ne sont pas fait pour moi”. Je m’en doutais avant lecture. Ce recueil des nouvelles n’a fait que confirmer une intuition. Mais pourquoi le lire alors ? Longue histoire que je vais faire courte. Pour le prix des blogueurs du Planète-SF, je vais devoir rattraper – sans grand enthousiasme avouons-le, cf ce billet-ci – La ménagerie de papier de Ken Liu. Comme il n’y a pas une critique sans référence à Ted Chiang (et à sa nouvelle “L’Enfer, quand Dieu n’est pas présent” au sommaire de ce recueil), je me dis que le minimum, pour être sérieux, c’est de lire Ted Chiang avant de lire Ken Liu. La lecture commune du Cercle d’Atuan, en juin, tombait à point nommé.
Les textes de Ted Chiang ne sont pas fait pour moi. J’aime la SF, mais Je préfère la SF qui parle à mon cerveau et à mes tripes. J’ai besoin d’humanité et d’idées. Côté idées, les nouvelles de Chiang n’en manquent pas (vertige garanti). Côté humanité, je cherche encore. La SF de Chiang est trop conceptuelle, “théorisante” pour moi. Intelligente, et difficile à comprendre parfois (mon ego le vit bien, précisons-le), son objet reste la science (pour la science). Elle ne se penche pas assez sur les conséquences (notamment sociétales) des idées qu’elle met en place.
Revue de détail des textes au sommaire.
“La Tour de Babylone” : tout premier contact avec la prose de Ted Chiang. Jusqu’ici tout va bien. L’auteur revisite la tour de Babel avec brio et une cohérence qui tient la route, de la construction du texte, irréprochable jusqu’au twist final, à celle des personnages. Ted Chiang parvient à rendre vraisemblable cette tour impossible et à faire toucher du doigt voute du ciel au sens propre. Le soin apporté à la construction de la tour elle-même, avec les détails techniques, les rampes, l’ascension par équipes etc sont de bonnes trouvailles pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Jusqu’ici tout va bien.
“Comprends” a reçu le prix Asimov’s catégorie novelette en 1992. Le narrateur, après un grave accident et un coma dépassé, a reçu un traitement médical novateur et expérimental : des injections d’hormone K qui décuple l’intelligence. Au fur et à mesure des injections, son niveau de compréhension, de conception et de conceptualisation dépassent de loin l’entendement humain traditionnel.
Dans un premier temps, le lecteur pense (automatiquement) à Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Mais, là où Keyes insuffle vie et émotions à son personnage (et suscite l’empathie du lecteur), Chiang choisit la direction opposée : le narrateur de “Comprends” devient une parfaite machine à réfléchir, logique, conceptualisant à tout va, maîtrisant corps et émotions. On dirait l’exact processus inverse de l’intelligence artificielle : au lieu d’avoir un ordinateur qui accède à la conscience, on a une conscience qui se reprogramme en permanence pour ressembler à une machine à penser. Et cette perte des caractéristiques “humaines” du narrateur m’a profondément ennuyée. Au bout d’un moment, je me fichais bien de savoir où allait l’auteur, même si la question de savoir vers quoi son personnage évoluerait m’intéressait encore. J’aurais bien zappé quelques pages (d’abstraction sur la création d’un langage par ex, intéressant en soi, mais barbant dans le traitement) pour arriver à la confrontation finale. Alors, oui, les perspectives que ce texte ouvre sont vertigineuses (caractéristique de la bonne SF, littérature d’idée etc) mais qu’est-ce qu’il m’a barbé dans sa forme…
“Division par zéro”. Imaginez un instant que vous soyez une mathématicienne de génie. Imaginez que, dans vos recherches, vous parveniez à démontrer que les mathématiques n’ont pas de sens logique. Comment vous sentiriez-vous ? Mal. C’est l’histoire de Renée Norwood. Sa vie, privée de sens, s’écroule. Rénée, son esprit cartésien privé de la cohérence et de la logique mathématiques, s’approche dangereusement de la folie : dépression, tentative de suicide, auxquelles il faut ajouter un couple qui se délite (même si l’enjeu de cette partie de l’histoire semble bien anecdotique tant son traitement suscite peu d’empathie).
L’histoire est construite à rebours : nous faisons connaissance avec Renée lorsqu’elle sort de l’hôpital où elle a fait un court séjour après sa tentative de suicide. Ted Chiang remonte le temps par flash-back à la chronologie non linéaire (malgré tout, le lecteur ne se perd pas en route) et entrecoupe ses tranches de vie de théories et d’explications mathématiques. La numérotation des tranches joue aussi sur cette logique mathématique.
Un mot ? Frustrant. J’ai l’impression d’être complètement passée à côté du sens profond de la nouvelle et, en conséquence, de ne pas en saisir toutes les implications (notamment à cause de la numérotation des tranches de vie). C’est très frustrant de sentir qu’on reste en surface. Le traitement est tellement distant, tellement froid, que je n’ai rien retenu du texte, rien ne m’a marquée.
“Comme bien d’autres avant elle, elle avait toujours considéré que les mathématiques ne puisaient pas leur signification dans l’univers, mais imposaient un sens à ce dernier. Les entités physiques n’étaient pas plus ou moins grandes l’une que l’autre, ni semblables ni dissemblables ; elles existaient, tout simplement. Bien qu’indépendantes, les mathématiques leur apportaient virtuellement une signification sémantique en établissant des catégories et des rapports. Elles ne décrivaient aucune qualité intrinsèque, elles se contentaient de fournir une interprétation.
Rien de plus. Séparées de toute entité physique, les mathématiques perdaient leur cohérence… une cohérence indispensable à toute théorie formelle. Devenues empiriques, les maths n’avaient plus le moindre intérêt.
“L’histoire de ta vie” : la meilleure nouvelle du recueil. Elle a reçu les prix Nebula et Theodore Sturgeon. Louise Banks, linguiste, travaille sur le langage des extra-terrestres pacifiques et mystérieux qui sont entrés en contact avec les habitants de la Terre. En parallèle, elle narre l’histoire passée ou future de sa fille. Le construction est magnifique, le jeu sur le langage et sur la manière dont il façonne la pensée qui, pourtant, le précède est impressionnant. La forme, déstructurée de prime abord, mais parfaitement maîtrisée, renforce les idées de fond et la mécanique fonctionne. Le traitement des personnages apporte enfin l’émotion et l’humanité qui m’avaient manqué dans les précédents textes.
“Soixante-douze lettres” est le texte qui m’a le plus agacée. J’ai apprécié les idées (oh ! une uchronie), le contexte rétro-futuriste, le mélange des genres entre science et religion (la science perfectionne les golem automates). Mais la narration m’a rebutée du début jusqu’à la fin. Ce texte m’a paru tout de même très très long. Les idées sont là mais la mise en musique fait cruellement défaut. Le comportement des personnage ne paraît pas toujours crédible (certains dialogues sont catastrophiques) et les scènes d’action mal fichues (la scène de l’agression et de la course poursuite dans l’usine est digne d’un sous Indiana Jones). “Soixante-douze lettres” été nominée au prix Hugo et a reçu le Sidewise Award (un prix qui récompense des … uchronies).
Dans “L’évolution de la science humaine”, l’humanité atteint un stade supérieur : les méta-humains. Ces méta-humains font évoluer le langage et la science au point de les rendre incompréhensibles au commun des mortels. Un texte rédigé à la manière d’un article publié dans une revue scientifique (il a d’ailleurs été publié dans Nature). Un bel exercice de style doublé d’une mise en abyme, mais qui m’a barbé du début jusqu’à la fin.
“L’Enfer, quand Dieu n’est pas présent” a reçu les prix Hugo, Locus et Nebula. Neil Fisk est athée. Il ne croit pas en Dieu mais voit sa femme mourir lors d’une visitation de l’Ange Nathanaël. Elle monte, littéralement, au ciel. Or il sait qu’il est promis à l’enfer (et condamné par là même à une séparation éternelle). Il va chercher par tous les moyens à apprendre à aimer Dieu pour gagner sa place au paradis. Après lecture, “L’erreur d’un seul bit” redescend encore dans mon estime. Le traitement est tellement différent. Et l’arbitraire divin de cet Enfer me semble bien plus logique et cohérent (je suis athée au fait) que l’épiphanie présente dans “L’erreur d’un seul bit”. Moralité, j’ai encore moins envie de lire La ménagerie de papier maintenant, c’est malin.
“Aimer ce que l’on voit : un documentaire”. La calliagnosie permet de déconnecter la perception physique du jugement esthétique. Les notions de beauté et de laideur n’existent plus pour celui qui porte la “calli”. Tamera Lyons a grandi sous calli dans une communauté où elle était obligatoire pour les enfants jusqu’à leur majorité. A 18 ans, elle décide de déconnecter sa calli. Sur le campus de l’université qu’elle a intégré, une association étudiante propose de rendre obligatoire la calliagnosie pour lutter contre une nouvelle forme de discrimination. Cette initiative suscite un débat qui prend une ampleur nationale. La calliagnosie menace aussi lres revenus des publicitaires et des entreprises qui profitent d’innovations technologiques pour embellir les produits et pousser les gens à consommer toujours plus. Les témoignages de Tamera, de ses parents, de neurologues, d’étudiants, professeurs alimentent le débat et le lecteur, tout comme les personnages, se trouvent bien en peine de prendre position sur la calliagnosie. Enfin ! Le fond et la forme. De vrais personnages, humains, vraisemblables. Des dialogues crédibles. Une réflexion sur la façon dont la société intègre une découverte scientifique. Tout ce que j’attends habituellement d’une nouvelle de SF est là dedans.
En fin d’ouvrage, Ted Chiang revient sur chacune des nouvelles au sommaire : ses inspirations, ses intentions. Ces pages se révèlent très intéressantes (et parfois plus intéressantes que les nouvelles elles-mêmes)
Bilan après lecture : je reste mitigée. Ted Chiang ce n’est pas pour moi. Et j’ai encore moins hâte de lire Ken Liu, ce qui n’était pas l’effet escompté.

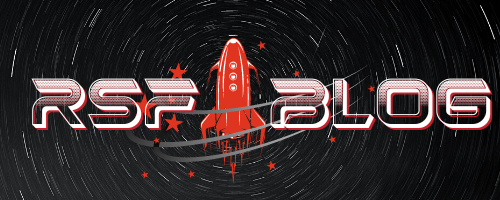


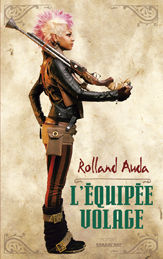
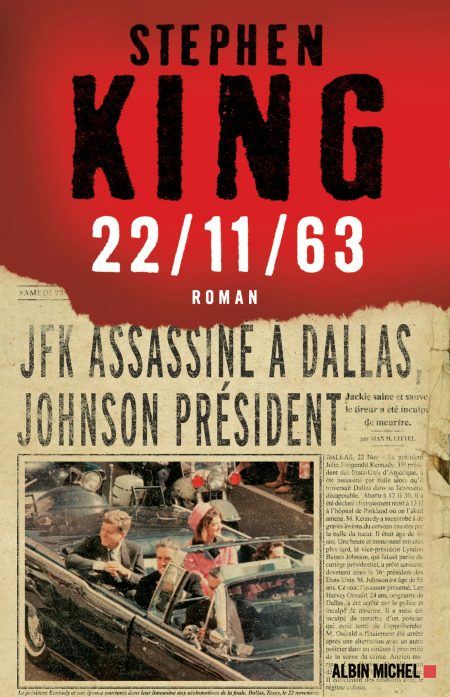
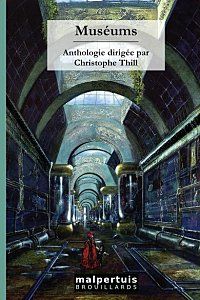
A part « L’Enfer, quand Dieu n’est pas présent » et « La Tour de Babylone » je n’avais pas du tout aimé ce recueil. En plus il y avait une histoire sur la traduction (mal faite ?) à l’époque.
Bref, dommage. Je préfère Greg Egan.
NicK.
Oh les trad, c’est toujours la même rengaine, quand on peut lire en VO c’est mieux.
Moi j’en garde une bonne impression au final (et en fait je pense que c’est en partie ta faute, à force de te voir énoncer tout ce qui n’allait pas, j’ai fini par aller chercher ce qui allait bien ^^).
J’aurais au moins servi à quelque chose 😉
En tout cas, s’il n’y avait pas eu la LC, j’aurais laissé tomber avant la fin.
Pas très convaincu non plus. Il y a des idées oui, ça c’est évident, mais pour l’humanité c’est un peu plus compliqué.
Je sais que tu as débuté ta lecture de Ken Liu, mais Ken Liu c’est justement pour moi le juste milieu entre idées et humanité, et c’est juste excellent. Et surtout ça n’a, à mon sens, pas grand chose à voir avec Ted Chiang. 😉
C’est marrant, tous/tes les avis / critiques mentionnent Ted Chiang tandis que plusieurs lecteurs m’ont assuré que ça n’avait rien à voir. Je suis perplexe 😉
Je n’ai pas encore dépassé la préface (cause travaux) de La Ménagerie et j’ai déjà râlé, ça promet.^^
Alors bonne lecture ! 😉
Concernant l’allusion à Chiang, je me cite (et mon ego se porte bien !^^) :
“Ken Liu est régulièrement comparé à Ted Chiang (que je n’ai pas lu)”, je reprenais des on-dit. Et du coup, après lecture je persiste : c’est très différent, et Ken Liu c’est bien mieux. 🙂
Maintenant qu’il ne me reste qu’une nouvelle de la Ménagerie à lire, je peux manifester mon accord avec cette affirmation 🙂
Ping : KillPal - Bilan 2015 - RSF Blog
Ping : Premier contact - Denis Villeneuve - RSF Blog